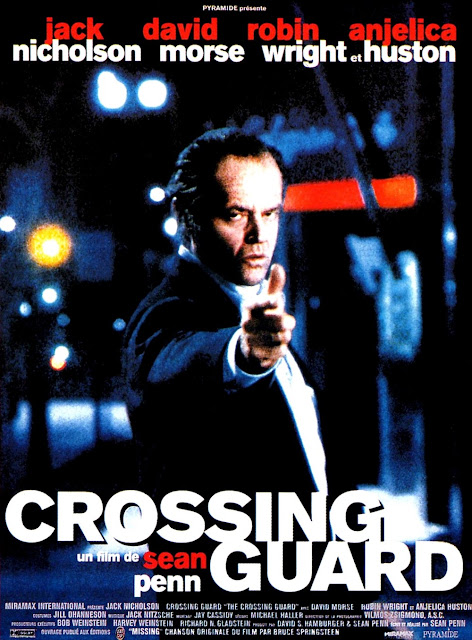Sean Penn est un cinéaste trop rare. Ses trois
premiers films, de Indian Runner (1991)
à The Pledge (2001), en passant par Crossing Guard (1995), répètent comme
une longue plainte douloureuse, des
déchirures familiales qui n'en finissent pas de hanter celles et ceux qui
tentent malgré tout de survivre. Dans Crossing
Guard, Mary (Anjelica Huston) a perdu, il y a six ans sa fille Emily,
renversée par un chauffard ivre, John Booth (David Morse). Revêtue d'un manteau
noir au milieu d'un océan de verdure que tentent d'égayer, de manière
discontinue, cinq bouquets de fleurs, Mary n'est plus, le sol s'étant dérobé
sous ses pieds. Assise sur le gazon du cimetière, surplombant la plaque
funéraire et le bouquet qui l'ornemente, elle s'abandonne à ses pensées en fermant
les yeux, fissurée de l'intérieur, comme terrassée par sa blessure, Vers qui ou vers quoi, son esprit erre-t-il à cet instant ? Vers Emily ? Sans l'ombre d'un
doute, mais aussi vers sa vie passée, vers son ex-mari Freddy (Jack Nicholson)
qui n'en finit plus de s'autodétruire, ou encore vers cet horizon lointain qui
pourra peut-être un jour lui permettre de se relever. Sean Penn multiplie les
signes d'une proximité avec l'affliction et la détresse en filmant Mary seule
dans le cadre, les jambes repliées, indifférente aux jeux des deux enfants qui
lui restent et qui s'amusent, hors-champ, à courir en slalomant autour des
plaques funéraires. Mais surtout le réalisateur choisit de donner à ce plan une
valeur graphique décuplée en privilégiant le point de vue, non pas de
l'observateur invisible, mais de celui de John Booth précisément. C'est lui
qui, à ce moment, un bouquet de fleurs à la main, voit Mary endeuillée. Sorti
de prison après avoir commis l'irréparable, incapable d'assumer sa faute et
rongé par la culpabilité, il s'est dirigé vers la tombe de celle qu'il a
renversée quelques années plus tôt, à la recherche d'une rédemption impossible.
À la vue de Mary, il se précipite pour se cacher derrière une pierre tombale, refusant
la confrontation et ce moment de vérité qui aurait mis à nu sa honte et ravivé
le chagrin de la mère. Entre ces deux êtres déchirés plane l'ombre d'un fantôme,
d'une âme errante : une petite fille dont aucun flashback ne nous révélera la
physionomie comme pour mieux éviter la facilité d'une émotivité gratuite et
cerner davantage les réactions des adultes. Car entrer dans le monde de Mary
est comme entrer dans un monde de souvenirs avec la mort comme partenaire, et quitter
le présent, le laisser à distance. Emmurée dans son silence, et alors que les
rayons du soleil caressent son visage, Mary présente ce mélange d'abandon et de
tragique qui embrase tout le film.
vendredi 20 septembre 2019
dimanche 25 août 2019
L'anachronisme chez David Miller
Dans Seuls
sont les indomptés (Lonely Are the
Brave, David Miller, 1962), Jack Burns (Kirk Douglas) est un cowboy sans
domicile fixe, errant à travers les plaines du Nouveau-Mexique, vivant d'expédients,
dormant à la belle étoile et ayant pour tout compagnon de route son cheval
prénommé Whisky. Épris de liberté, individualiste forcené et refusant toutes les
contraintes autres que celles qu'il s'impose, il se rend à ce moment dans une
ville pour revoir son ancienne amie Jerry (Gena Rowlands). Mais alors que Jack tente
de traverser une autoroute qui coupe son itinéraire, des voitures et des
camions surgissent brutalement dans le cadre, manquant de l'écraser. Le cheval renifle,
hésite, se cabre, prend peur, ne peut ni avancer ni reculer, virevolte et
menace à tout moment de renverser son cavalier. Les klaxons, les injures et les
visages interloqués derrière les pare-brises encerclent celui qui reste
insensible à toute cette agitation. Désormais l'asphalte a remplacé les
anciennes pistes chaotiques et poussiéreuses qu'empruntaient jadis les
troupeaux de bovins, et les voitures se sont substituées aux chariots bâchés
pour de nouvelles transhumances vers ce qui n'est plus une terre vierge, mais
un espace quadrillé par des villes et des routes. La Conquête de l'Ouest est
terminée depuis longtemps et l'esprit des pionniers à l'assaut de la Frontière,
cette ligne imaginaire séparant la civilisation de la sauvagerie, est désormais
entre les mains des historiens. Ce n'est
pas le cas pour Jack, un ancien combattant de la guerre de Corée, qui persiste
à être le vestige d'un temps révolu, un anachronisme croyant faire perdurer un
mode de vie qui n'a plus cours, un solitaire et un anarchiste défiant les
conventions et l'ordre établi. Hors-la-loi flamboyant, mais sans la violence
qui accompagne habituellement ce statut, Jack est aussi inadapté au monde
moderne qu'un Tom Doniphon (John Wayne dans L'Homme
qui tua Liberty Valance de John Ford tourné la même année). Sa silhouette à
cheval emprisonnée dans le rétroviseur du camion désigne bien ce passé auquel
Jack s'accroche envers et contre tout. Cette autoroute dont le bas-côté droit
est jalonné de poteaux électriques qui ont remplacé les poteaux télégraphiques
d'antan, glisse vers son point de fuite, un horizon bloqué par une rangée
d'arbres. Pourtant en s'exposant ainsi à ce flot continu de véhicules de
manière aussi désinvolte et provocatrice, Jack se comporte comme un
trompe-la-mort, bien conscient qu'il est au bout de la piste et qu'il n'a plus
rien à attendre de ses semblables. Cette dimension suicidaire qui le pousse à
rompre les amarres illustre bien la contradiction opposant son monde intérieur
constitué d'espaces libres et sans entraves à celui du monde extérieur, réel,
corseté et conformiste. Faux western mais véritable ode nostalgique à ce genre
cinématographique, Seuls sont les
indomptés annonce sinon sa fin, du moins son crépuscule. Tirée du livre
d'Edward Abbey (1) et scénarisée par Dalton Trumbo – encore mis à l'index par
la liste noire du maccarthysme – l'histoire de Jack Burns refusant la modernité
tout en se marginalisant renvoie aux thématiques des anti-héros qui seront
développées quelques années plus tard par les cinéastes du Nouvel Hollywood.
(1) The Brave Cowboy d'Edward
Abbey, 1956. Pour l'édition française, Seuls
sont les indomptés, Gallmeister, 2015
lundi 19 août 2019
La figure du cercle chez Clint Eastwood
1
2
3
À l'exception de L'Homme des hautes plaines (High Plains Drifter, 1973) et de Pale Rider, le cavalier solitaire (Pale Rider, 1985), la mise en scène de Clint Eastwood n'a jamais été aussi redevable de l'univers de Sergio Leone que dans cette séquence extraite de son film réalisé en 1983, Le Retour de l'inspecteur Harry (Sudden Impact). Une nuit, à San Paulo, une petite ville de Californie, Jennifer Spencer (Sondra Locke, photogrammes 1 et 2) est poursuivie par trois malfrats dont l'un, Mick (Paul Drake, photogramme 3) a participé au viol de la jeune femme et de sa sœur dix ans auparavant. Profitant de l'obscurité, elle se réfugie dans un manège de chevaux de bois qui jouxte la plage bordant le Pacifique et le met en marche. Se déplaçant à moitié courbée entre les chevaux, alors que la plateforme entame son mouvement circulaire, Jennifer tente d'échapper à ses poursuivants qui, eux aussi, ont pris pied sur le carrousel. Entre ombre et lumière, sa silhouette se confond dans la contradiction de deux mouvements : la rotation horizontale du carrousel et le mouvement vertical lancinant que font les chevaux fixés à leurs barres. Les nombreux plans sur son visage angoissé et les stigmates des coups qu'elle vient de recevoir révèlent le calvaire qu'elle subit au cœur des ténèbres et du chaos. Espace corrompu par la violence, ce manège évoque la figure circulaire chère à Sergio Leone que l'on peut voir dans certains de ses films : le cimetière de Sad Hill dans Le Bon, la Brute et le Truand (The Good, the Bad and Ugly, 1966) et le muret encerclant Harmonica et Frank dans Il était une fois dans l'Ouest (Once Upon a Time in the West, 1968) sont tout autant des arènes mettant en scène des catharsis que des révélateurs de la vérité de chacun des personnages. Tout a commencé ici (Jennifer et sa sœur ont été violées non loin de là) et tout va se terminer dans cet espace forain endormi. Symbolisant l'enfermement et le vertige, le mouvement sans fin du carrousel traduit le malaise existentiel de Jennifer, son écoeurement vis-à-vis du monde qui n'a pas su être attentif à son traumatisme, et sa part d'ombre, elle qui n'hésite pas, dans un désir de vengeance insatiable, à tuer tous ceux qui ont participé jadis à son malheur et à celui de sa soeur. Sa vérité est celle d'un enfer à ciel ouvert qui ne peut trouver sa résolution qu'au beau milieu de ce lieu à priori ludique et familier, mais ici hanté par le souvenir d'une blessure qui ne cicatrise pas. La tonalité funèbre et cauchemardesque de la séquence, ainsi que la violence graphique que déploie Clint Eastwood soulignent la confrontation de Jennifer à ses démons intérieurs et surtout à ce démon, Mick, qui inexorablement se rapproche de sa proie. Fouillant de ses yeux l'obscurité, celui-ci s'est arrêté à côté d'une licorne dont la corne, par son mouvement ascendant et descendant, déchire littéralement l'écran. Les circonvolutions nauséeuses de son cerveau de criminel sont soulignées par les travellings circulaires de la caméra, une contre-plongée menaçante et un éclairage expressionniste violemment contrasté coupant son visage en deux. Brutal clone d'un croisement entre Scorpio (le tueur dans L'Inspecteur Harry/Dirty Harry, Don Siegel, 1971) et de Stacy Bridges (un autre tueur dans l'Homme des hautes plaines), il ne sait pas encore qu'il ne lui reste que quelques instants pour disparaître définitivement dans la nuit.
lundi 29 juillet 2019
La femme fatale chez Bob Rafelson
Le plaisir extrême que l'on prend à la vision du
film de Bob Rafelson, Le Facteur sonne
toujours deux fois (The Postman
always rings twice, 1981), tient, bien entendu, au scénario rédigé par
David Mamet d'après le roman éponyme de James M. Cain. Durant la Grande
Dépression, Frank Chambers (Jack Nicholson) erre sur les routes de Californie.
S'étant arrêté pour manger dans une station-service tenue par Nick Papadakis
(John Colicos), il est subjugué par sa femme Cora (Jessica Lange), entre- aperçue
affairée dans la cuisine, et il décide d'accepter le poste de mécanicien que
son mari lui propose. « Son corps mis à part, elle n'était pas d'une
beauté folle, mais elle avait un certain air boudeur et des lèvres qui
avançaient de telle façon que j'ai immédiatement eu envie de les mordre ».
(1) Au contraire de la description de
Cora faite par James M. Cain, Jessica Lange irradie l'écran de sa beauté, une
beauté qui fait faire au cœur un bond jusqu’au fond de la gorge pour mieux
retomber en chute libre et vertigineuse au creux de l'estomac. Visiblement,
Cora produit le même effet sur Frank que sur le spectateur. Avec sa chevelure
blonde ondulée mi-longue, son visage solaire dont les yeux fixent intensément
Frank, sa bouche entrouverte, orgueilleuse et provocante, elle va unir sa
destinée à celle de Frank. Tout les oppose à priori: elle est mariée, attachée
à ce bout de terre, enfermée dans les servitudes domestiques quotidiennes, lui
est un vagabond sans attaches, vivant d'expédients au jour le jour, refusant
les contraintes quelles qu'elles soient. Devenus instantanément amants, ils
vont vivre une relation fusionnelle, pulsionnelle et violente, uniquement
bridée par la présence d'un mari encombrant dont l'élimination apparaîtra
bientôt comme la seule issue possible. Histoire archétypale du trio infernal, Le Facteur sonne toujours deux fois de
Bob Rafelson, remake incandescent de
la précédente version tournée par Tay Garnett en 1946, fait de Cora une femme
fatale dont l'éclat et la grâce masquent mal une part d'ombre criminelle. « Je te veux pour moi, Frank ….. si on n'était
que nous deux …. que toi et moi »
dit-elle en fixant son amant. « Qu'est-ce
que tu veux dire ? » répond Frank. « J'en
ai assez de ce qui est bien ou mal » rétorque-t-elle. « On pend les gens pour cela, Cora » lance Frank, mi-inquiet,
mi-interrogateur. L'engrenage mortel est désormais lancé. À ce moment précis,
ils sont convaincus que leur passion mutuelle est suffisante pour s'affranchir
de la médiocrité sentimentale dans laquelle ils baignaient jusqu'à présent.
Choisissant l'ivresse du corps et l'extase qui l'accompagne plutôt que la
morale, Cora et Frank signent explicitement un contrat de nature faustienne
pour se lancer vers l'abîme, ou plutôt pour voir le monde tel qu'ils se
l'imaginent et dans lequel la liberté de se choisir une autre vie ne serait pas
une idée vaine. Au contraire de Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort/Double Indemnity, Billy Wilder, 1944, une
autre adaptation d'un roman de James M. Cain), nul désir de lucre dans l'esprit
de Cora, mais une soif toujours renouvelée de vivre pleinement avec Frank un
amour qui leur appartient désormais, tout en sachant que le prix à payer sera
élevé.
jeudi 18 juillet 2019
Le bad guy chez Lawrence Kasdan
Dans Silverado
(Lawrence Kasdan, 1985), Tyree (Jeff Fahey) est un bad guy de haute volée. Au service de Cobb (Brian Dennehy), un
shériff aussi flamboyant que retors, il incarne un homme de main sans
scrupules, aussi rapide à dégainer qu'impitoyable envers quiconque se met en
travers de son chemin. Pour son premier rôle à l'écran, on ne peut pas dire
qu'il passe inaperçu en volant la vedette à tous les acteurs (Kevin Kline,
Scott Glenn, Kevin Costner ou Danny Glover) qui se trouvent autour de lui. Dans
le saloon de Silverado, qui perd régulièrement une partie de sa clientèle
chaque fois qu'il fait une apparition, Tyree, yeux hallucinés, regard
magnétique et corps nerveux tendu à l'extrême, est toujours prêt à envoyer ad
patres l'infortuné vis-à-vis. Alors qu'il aime manifestement se donner en spectacle,
il est immédiatement habité par une rage doublée d'une jouissance inextinguible
qui menacent d'exploser au moindre éternuement ou raclement de gorge d'un
inconscient tétanisé par la peur. Toujours armé d'une Winchester ou d'un colt,
voire des deux à la fois, Tyree n'envisage la vie que comme un rapport de
force, une confrontation perpétuelle avec l'autre, comme si sa haine du monde
était le moteur de son existence. Il est rancunier, « j'aurais dû te tuer il y a longtemps » dit-il à Paden (Kevin
Kline), un ancien comparse rentré dans le droit chemin, n'aime pas les chiens,
« où est le chien ? » assène-t-il avec
un sourire cruel, de manière péremptoire et énigmatique, encore une fois à
Paden, et reste doté d'une aura maléfique qui en fait le double de son
employeur, le shériff Cobb. Osons une analyse comparée doublée d'une mise en
perspective: Tyree n'est pas cet outlaw de
second rang que l'on peut rencontrer dans Les
Grands espaces (The Big Country,
William Wyler, 1958) ou dans Tombstone
(George Pan Cosmatos, 1993) sous les traits respectivement de Buck Hannassey
(Chuck Connors) et Ike Clanton (Steven Lang), aussi bravaches en groupe que
pleutres isolés, non, Tyree est plutôt de la trempe de Charlie Prince (Ben
Foster dans 3h10 pour Yuma/3:10 to Yuma,
James Mangold, 2007), un ange de la mort brûlant d'un feu intérieur et laissant
derrière lui souffrance et cadavres. Nous sentons chez ces deux personnages une
incapacité congénitale à supplier, à geindre ou à se lamenter du mauvais sort. Au-dessus
du commun des mortels en dépit de leurs névroses obsessionnelles, ils restent néanmoins
des seconds, caractérisés par une esthétique du malaise. Tyree, en particulier,
n'a pas de stature morale, s'accommode avec délice de l'adversité et trouve son
point de cohérence dans l'attitude qu'il donne à voir régulièrement: un monstre
froid et éruptif dont l'arrogance le dispute à la noirceur. La puissance du jeu
de Jeff Fahey donne à son personnage une dimension fascinante qui nous fait
regretter qu'il n'apparaisse pas plus souvent au cours du film.
lundi 15 juillet 2019
Le fils de bonne famille déchu chez John Ford
1
2
À deux reprises, au cours de sa carrière prolifique, John Ford filma un fils déchu de bonne famille. Hatfield (John Carradine dans la Chevauchée fantastique/Stagecoach, 1939, photogramme 1) et Doc Holliday (Victor Mature dans La Poursuite infernale/My Darling Clementine, 1946, photogramme 2) incarnent ce type de personnage dont le passé sera toujours en grande partie occulté, gardant cette part de mystère qui sied à ceux qui ont fui un ailleurs pas si lointain. Le premier, dandy sudiste et joueur de poker, fréquentant par la force des choses davantage les saloons enfumés ou l'alcool coule à flots que les salons mondains, a gardé toute la gestuelle, le verbe et l'apparence vestimentaire d'une famille probablement propriétaire d'une grande plantation du Mississippi ou de Géorgie. Revêtu d'un manteau couvrant un costume élégant et coiffé d'un stetson aussi immaculé que la neige au sommet des Rocheuses, il se livre à son jeu favori face à deux autres joueurs. À proximité, une canne, négligemment posée contre le rebord de la fenêtre, lui sert de signe d'appartenance à sa classe sociale, accessoire indispensable pour celui qui s'affiche, particulièrement au milieu des ivrognes qui peuplent le saloon de Tonto en Arizona. Toujours digne et respectueux envers les dames, associant courtoisie et galanterie, en écho à un passé qu'il cherche manifestement à oublier, Hatfield, en personnage tragique et romanesque, se retrouve de manière incongrue, dans cet Ouest sauvage sans que l'on sache pourquoi: une querelle de famille, une déception sentimentale, un héritage qui lui a été refusé ? John Ford ne nous livre aucune explication. Tout juste apprend-on à la fin du film que son père a été juge. À l'instar de Hatfield, Doc Holliday, venu de l'Est, se trouve en 1882 à Tombstone, toujours en Arizona. Chirurgien dans une vie antérieure, il contemple son diplôme encadré et accroché au mur de sa chambre, dernier vestige de ce qu'il a été. Dans la pénombre qui baigne la pièce, le reflet que lui renvoie la glace le met face à ses contradictions: lettré et donc éduqué (il est capable de réciter Shakespeare), toujours attentif à sa tenue vestimentaire (il porte cravate et costume), il n'en reste pas moins submergé de manière frénétique par l'alcool et des accès de violence. La bouteille qui se trouve à sa droite témoigne de son addiction au whisky et autres fortes liqueurs. Plus torturé qu'Hatfield, Doc a une part d'ombre qui le met à l'intersection du monde civilisé (l'Est) et du monde sauvage (l'Ouest), porté par des pulsions de mort et des tourments existentiels dont, là non plus, John Ford ne nous dira rien. Seule l'irruption de son ancienne fiancée, Clementine, également venue de l'Est, lui rappellera des souvenirs qu'il pensait avoir enfoui au plus profond de lui-même. Hatfield et Doc Holliday sont donc en définitive deux proscrits ne croyant plus à l'idée qu'ils pourront un jour retrouver la vie qu'ils ont laissée derrière eux tout en pensant que la fuite, le jeu, l'alcool ou la violence suffiraient à panser les plaies les plus intimes.
mardi 7 mai 2019
L'amour du classicisme hollywoodien chez Peter Bogdanovich
Anarene, Texas, 1951. Une ville meurt à petit feu
au fin fond du Lone Star State. Sa population, n'ayant pour seules distractions
qu'une salle de billard et un cinéma, trompe son ennui en ressassant ses
regrets ou en rêvant d'un ailleurs inaccessible. Les plus jeunes s'étourdissent
dans la découverte de leurs corps, tout en se heurtant à la morale et à
l'hypocrisie puritaines des plus âgés qui passent leur temps à tenter de reconstruire
un passé qui n'a plus d'avenir, à l'image de cette Amérique rurale en train de
mourir. Les premiers tombent amoureux, découvrent leurs premiers émois, se
trompent mutuellement, alors que les seconds refusent de croire que tout cela
ne fut qu'un temps. Les deux se rejoignent dans une fuite en avant pour tenter d'exister
dans un désenchantement général et une tristesse sans fin. Dans La Dernière séance (The Last Picture Show, 1971), Peter Bogdanovich filme une chronique
plus amère que douce d'Américains en perte de sens et d'identité. La nostalgie
irradie chaque plan du film : nostalgie d'une époque (les années cinquante)
avec sa ville, sa rue principale balayée par les
bourrasques de sable, ses décapotables et ses motels décrépits, mais surtout
avec son cinéma, le Royal. Le film
s'ouvre sur sa façade avec son guichet bien visible, alors que les rues sont
vides tout autour (photogramme 1).
À l'affiche, Le Père de la mariée (Father
of the Bride, Vincente Minnelli, 1950). Ici, tout le classicisme
hollywoodien est mis en scène pour mieux prendre à contre-pied la désespérance
de cette ville qui a tout de la ville fantôme. L'humour du film de Minnelli –
un père prépare le mariage de sa fille tout en se demandant si le futur mari
est le bon – son rythme enlevé, sa glorification du mariage et de l'American dream s'opposent
intégralement aux habitants d'Anarene et à leur vacuité sentimentale et
existentielle. La nostalgie du classicisme hollywoodien s'incarne également dans
le souvenir d'autres films, et plus particulièrement, dans le western et dans un
acteur emblématique de ce genre cinématographique : Ben Johnson (photogramme 2).
Le personnage diégétique qu'il incarne (Sam le lion, propriétaire de la salle
de billard et du cinéma Le Royal) ne peut s'appréhender en dehors de l'acteur
qui l'interprète. Entretenant donc la confusion entre ce rôle et les rôles qui
l'ont rendu célèbre chez John Ford (soldat dans Le Massacre de Fort Apache/Fort
Apache, 1948, guide de convoi dans Le
Convoi des braves/Wagon Master, 1950),
ou encore hors-la-loi chez George Stevens (L'Homme
des vallées perdues/Shane, 1953),
Ben Johnson personnifie ce passé, non avec l'aura d'un John Wayne ou d'un James
Stewart, mais avec celle de celui qui a joué, tout au long de sa carrière, des
seconds rôles. Assis au bord d'un étang, il évoque sa nostalgie, forcément
élégiaque, des temps anciens, méditant sur le temps qui passe inexorablement et
sur la place qu'il tient en tant qu'âme et témoin d'une ville qui dépérit, mais
aussi du classicisme westernien qui n'a quasiment plus cours en 1971. La nostalgie
du vieil Hollywood ne s'arrête pas là. Par la grâce d'un lent travelling
latéral, Bogdanovich nous fait découvrir une nouvelle fois, mais de nuit, le
fronton illuminé du cinéma de Sam (photogramme 3), présentant Winchester 73, un western d'Anthony Mann
avec James Stewart, tourné en 1950.
L'exposition en pleine lumière de ce film est d'autant plus
remarquable qu'il décrit la détermination et l'opiniâtreté d'un homme à venger
la mort de son père, alors que la population d'Anarene courbe l'échine,
satisfaite de son sort ou, dans le meilleur des cas, incapable de briser les
pesanteurs de ses habitudes. La même remarque prévaut pour les ultimes plans de
La Dernière Séance (photogramme 4). Avant
que le cinéma de Sam ne ferme ses portes, faute de spectateurs plus attirés par
la télévision que par la salle obscure, la dernière projection n'est autre que La Rivière rouge, un western d'Howard
Hawks (Red River, 1948), film
dans lequel jouait justement Ben Johnson (en tant que cascadeur), mais sans
qu'il ait été crédité au générique par le réalisateur de Rio Bravo (1959).
L'opposition entre l'épopée visible sur l'écran –
un troupeau de dix-mille bovins doit être mené du Texas au Missouri - et l'alanguissement des habitants d'Anarene
ne fait que redoubler le propos de Bogdanovich. Ces deux dernières mises en abyme
du classicisme hollywoodien renvoient donc à un type de western qui n'existe quasiment
plus en 1971. Seul Andrew V. McLaglen tentera de faire perdurer, avec moins
d'éclat et de manière anachronique, la geste fordienne dans des films comme Les Géants de l'Ouest (The Undefeated, 1969) ou encore Chisum (1970). Depuis la fin des années
60, le Nouvel Hollywood a, en effet, tout balayé sur son passage, et le
classicisme qui a caractérisé le western mais aussi tout le cinéma américain
depuis les années 20 explose sous les coups de boutoir de Martin Ritt (Hombre, 1967), de Sam Peckinpah (La Horde sauvage/The Wild Bunch, 1969), d'Abraham Polonsky (Willie Boy/Tell Them Willie
Boy Is Here, 1969), d'Arthur Penn (Little
Big Man, 1971) ou encore de Blake Edwards (Deux Hommes dans l'Ouest/The
Wild Rovers, 1971). Il n'y est
plus question de mythe mais de réalisme critique de l'Amérique, passée et
contemporaine.
samedi 16 mars 2019
Le rock chez les frères Maysles
Tout a été dit sur le sinistre festival
d’Altamont (Californie, le 6 décembre 1969) et le krach du rêve hippie des
années 60. Ce grand rassemblement musical et festif devait être le pendant d’un
autre festival, celui de Woodstock qui s’était déroulé du 15 au 18 août de la
même année. Ce sont les Rolling Stones en pleine ascension, et leur manager Sam
Cutler qui sont aux commandes. Après avoir invité des groupes déjà présents à
Woodstock (Jefferson Airplane, Carlos Santana ou Crosby, Stills, Nash and Young),
les Stones se réservent la meilleure part du gâteau en choisissant de passer en
début de soirée le 6 décembre. Pourtant, ils vont commettre une double erreur
fatale : d’une part celle de faire appel (suite à la proposition du
Grateful Dead) aux Hell’s Angels d’Oakland pour assurer le service d’ordre et
d’autre part, celle de les payer en packs de bières. Le cocktail réunissant
300 000 jeunes dont de nombreux accros au LSD et aux amphétamines, des
Hell’s très rapidement aussi avinés que violents, associés aux titres
anxiogènes (Sympathy for the Devil ou Street Fighting Man) joués par le groupe
mené par Mick Jagger et Keith Richards, ce cocktail donc, va se révéler
désastreux et aboutir au meurtre de Meredith Hunter par un membre du service
d’ordre. Le premier avait pointé une arme sur Mick Jagger avant d’être
poignardé par le second. Cette violence a été extraordinairement captée par les
caméras des frères Maysles, positionnées le plus souvent derrière le groupe sur
scène. Le photogramme montre, probablement sans l’avoir prémédité, la puissance
et la lucidité du point de vue adopté par les cinéastes : à gauche, au premier
plan, la silhouette floue de Mick Jagger face au public, et à droite, au
deuxième plan, un Hell’s Angel, net. La tension entre ces deux pôles vient du
fait que le Hell’s regarde avec un mépris incommensurable le chanteur des
Stones qui ignore tout de cette perception.
Et ici, d’une manière évidente, s’entrechoquent quasiment frontalement
deux visions du monde : celle d’un des hérauts de l’idéologie libertaire
des années 60 caractérisée par l’amour libre, la paix, la rupture avec les
générations précédentes et l’hostilité à la guerre au Vietnam, opposée à celle
de ce club de motards affilié au crime organisé. Tout dans leur attitude les
sépare : pour Mick, les cheveux longs, un vêtement en satin noir et rouge
dont les manches sont prolongées par deux très longues écharpes et, pour
le motard, des cheveux coupés très courts, un blouson noir, point de repère
indispensable pour les Hell’s Angels et dont on devine dans le dos, leur sigle
semi-circulaire. En un seul plan, les
frères Maysles captent la fracture idéologique qui fera l’échec de ce festival
et en même temps celui de la contre-culture des années 60. Cette fracture témoigne d’une
inconscience totale face « aux conflits non résolus qui s’affrontaient
silencieusement dans l’underground : le poids de l’argent, le manque de
leader, d’unité et de but, le rôle des drogues, le rejet de l’autorité et de la
police » [1] mais
également face à la violence environnante qui avait pourtant déjà frappé,
particulièrement au sein des États-Unis, dès le début de la décennie. Les
assassinats de John F. Kennedy (1963), Malcolm X (1965), Martin Luther King,
Robert Kennedy (1968) et celui, spécialement sordide, de l’épouse de Roman
Polanski, Sharon Tate le 9 août 1969 – à la veille de Woodstock ! – par la
bande de Charles Manson, serviront de cercueil à l’idéal communautaire du peace
and love. Le festival d’Altamont n’est finalement que la conclusion d’un
mouvement qui avait cru pouvoir changer le monde.
mercredi 13 mars 2019
Le plan débullé chez Elia Kazan
Dans
la famille Trask, tout est une affaire de déséquilibre. Le père, Adam (Raymond
Massey, à droite, photogramme 1) n'aime pas son fils, Cal, (James Dean,
photogrammes 2 et 3), et lui préfère son frère jumeau, Aron (Richard Davalos, à
gauche, photogramme 1), plus lisse et plus docile. En quête d'identité, écorché
vif, et cherchant par tous les moyens l'amour de son père tout en sachant manier la provocation pour lui tenir
tête, Cal se retrouve à la table familiale pour entendre un extrait de la bible
lu par son père. Celui-ci profite de tous les présumés écarts de conduite de
son fils pour lui faire la morale et lui rappeler que la parole divine est
l'alpha et l'omega de la famille. La séquence, extraite de À l'Est d'Eden (East of Eden,
Elia Kazan, 1955), essentiellement construite en champ-contrechamp, permet au réalisateur
de filmer individuellement le père ou le fils (photogrammes 1, 2 et 3) en plans rapprochés débullés, alors que le
plan de demi-ensemble (photogramme 4), filmé en angle plat, les présente réunis
dans le champ de manière définitive, les deux corps affaissés sur leurs chaises
et leurs regards divergents, pour mieux signifier leur incompréhesion mutuelle
de part et d'autre de cette interminable table. Le plan débullé (en référence
au niveau à bulle que l'on trouve sur un trépied et qui permet de filmer à
l'horizontale, en angle plat donc) produit un renversement des lignes verticales
et horizontales pour traduire le malaise, l'inquiétude et la tension qui
habitent les personnages dans le cadre. Ainsi, au sermon du père s'interrogeant
sur les actions de son fils, répondent les provovations de Cal, physique
d'abord par son attitude – faussement – décontractée, le bras droit soutenant
la tête et le bras gauche par-dessus le dossier de la chaise, puis verbale
parce qu'obligé de lire – ce qu'il fait de mauvaise grâce, à toute vitesse et
mécaniquement - les versets de la bible
qui lui a été donnée par le frère modèle, Aron. La tension redouble subitement lorsque
Cal pose des questions sur sa mère,
officiellement morte et enterrée, mais dont il a retrouvé la trace non loin du domicile
familial. « Talk to me, father »
s'exclame Cal dans une supplique qui déchire l'écran. En utilisant cet angle
aussi insolite que déstabilisateur, et bien qu'il n'en soit pas l'inventeur –
les cinéastes expressionnistes allemands l'ont abondamment utilisé, de même qu'Alfred
Hitchcock dans Les Enchaînés
(Notorious, 1946) ou encore Carol
Reed dans Le Troisième Homme (The Third Man, 1949) - Elia Kazan brise
néanmoins, en plein classicisme hollywoodien, les conventions habituelles de
tournage en associant simultanément un lourd secret de famille et un rapport conflictuel
au père ou à la mère au positionnement de la caméra. Ce dernier point, associé
au format cinémascope rejetant aux extrêmités les deux protagonistes, participent
de l'impossible communication au sein d'une cellule familiale destructurée, non
par l'argent comme la famille Stamper (La
Fièvre dans le sang/Splendor in the
Grass, du même Kazan, 1961), mais par l'aveuglement d'un père dont la
rigidité morale et le puritanisme exacerbé sont l'inverse du jardin d'Eden qu'il
désirait pour ses enfants.
samedi 9 mars 2019
Le cri chez Anthony Mann
Dans
L'Homme de l'Ouest (Man of the West, Anthony Mann, 1958), Link
Jones (Gary Cooper), un ancien truand repenti est rattrapé par son passé
lorsqu'il retrouve fortuitement le gang dont il fut l'un des membres autrefois.
Pour sauver sa vie, il accepte de participer au cambriolage de la banque de la
ville minière de Lassoo. Bien décidé à faire échouer le projet, il est
accompagné et surveillé par Trout (Royal Dano), un ancien comparse dégénéré et
violent. Mais, à leur grande surprise, Lassoo n'est plus qu'une ville
abandonnée, perdue au milieu du désert, une ville-fantôme en état de délabrement
avancé, le vestige d'un passé glorieux, pliant maintenant sous les bourrasques
du vent torride. Arpentant ces rues
désormais désertes, Link et Trout se présentent devant ce qui fut autrefois la
banque, mais n'y trouvent qu'une Mexicaine, unique survivante d'une ruée vers
l'or aussi éphémère qu’illusoire. Brandissant en tremblant un colt en direction
des deux hommes, celle-ci tente de les forcer à rebrousser chemin. Mais alors
que Link s'efforce de la tranquilliser, Trout, un muet au coefficient
intellectuel déficient, la tue dans un accès de rage frénétique et de joie
mauvaise. Link se jette alors au sol, s'empare de l'arme de l'infortunée
victime et la décharge dans l'abdomen de Trout (photogramme 1). Blessé à mort,
se tenant le ventre pour empêcher ses tripes de souiller le sable ocre et
brûlant, Trout dévale en titubant la rue principale (photogrammes 2,3,4 et 5).
Pour la première et dernière fois de sa vie, des cris rauques sortent de son
gosier, ultime manifestation d’une humanité enfouie dans un cerveau et un corps
déformés par l’ignorance et la violence. Au milieu de ces ruines en bois qui
menacent à tout moment de s'effondrer, ces cris de détresse et de douleur résonnent
comme un appel à l'aide dans le silence sépulcral de la vallée. Trout, sentant
que la vie est en train de s'échapper de son corps, exprime enfin, devant les
fantômes de la ville en décrépitude, cette rage intérieure qui le ronge depuis
toujours, lui qui n'a jamais pu s'exprimer autrement que par gestes. Sa
transformation brutale ouvre un abîme de solitude dérisoire, ironique et
désespéré, puisqu'il doit mourir pour pouvoir extérioriser, enfin, une
souffrance physique intolérable. Cet ultime face à face avec la mort qui
s'approche est une illustration de la violence sèche et fulgurante dont Anthony
Mann témoigne dans ses films. Tout au long de L'Homme de l'Ouest, rien ne laissait subodorer que Trout pouvait à
ce moment susciter une telle aura de miséricorde, alors qu'il venait tout juste
d'abattre une femme sans défense. C'est ce paradoxe qui donne toute sa
puissance à cette séquence. À l'instar de Waco Johnny Dean (Winchester 73, 1950), Ben Vandergroat (L'Appât/The Naked Spur, 1953) ou encore Gannon (Je suis un aventurier/The Far
Country, 1954), les personnages manniens sont toujours victimes de la
violence qu'ils déclenchent, mais avec ce surcroît d'éclat qui fait d'eux des
personnages que nous aimons détester. Après quelques secondes de course
éperdue, Trout finit par s’effondrer dans la poussière, pour rendre l’âme dans
une dernière convulsion (photogramme 6).
La toile d'araignée chez Robert Siodmak
Dans ce plan des Tueurs (The Killers, Robert
Siodmak, 1946), la mise au point est faite sur Kitty Collins (Ava Gardner),
alors que Ole Andreson, dit le Suédois (Burt Lancaster), reste légèrement flou.
Sorti récemment de prison, il n'a plus de nouvelles de Kitty qu'il a rencontrée
quatre ans auparavant et dont il était tombé immédiatement amoureux. Depuis
qu'il est entré dans cette pièce dans laquelle quatre comparses préparent le
hold-up d'une usine, Ole s'est assis parce que ses genoux chancelaient. La
sensualité que dégage Kitty, langoureusement étendue sur le lit, le regard de
braise qu'elle lui lance donnant l'impression que la pellicule va s'embraser
contrastent avec l'insécurité et le regard perdu et fuyant de l'homme qui a
besoin d'être soutenu par la barre horizontale métallique du pied de lit pour
soigner une illusion de contenance. Il n'ose affronter le regard de celle qu'il
aime toujours éperdument, au-delà de toute raison, dans une volonté d'absolu, avec
une passion qui le consume de l'intérieur, une adulation inextinguible qui
confine au mysticisme et que Kitty lui rend si mal, parce que préoccupée par
d'autres réalités nettement plus matérialistes. Loin de la robe de satin noir
qu'elle portait lors de leur première rencontre, elle porte ce soir-là, une jupe
et un pull-over qui ne parviennent pas à la faire passer pour une femme
ordinaire. Sa jambe découverte jusqu'au genou accentue la tension érotique qui
se dégage du plan. La caméra – comme le spectateur - est subjuguée, hypnotisée
par ces yeux, ce visage et ce corps, qui expriment le sous-entendu et ce
demi-sourire esquissé qui rend possible le passage de l'autre côté du rêve. Ole
voudrait la serrer dans ses bras, lui dire que rien n'a changé depuis la
première fois, qu'il est resté le même, qu'il a conservé le foulard vert décoré
de harpes d'or qu'elle lui avait donné, qu'il est prêt à tout, même au pire,
pour retrouver son ancienne maîtresse. Envoûté, depuis la nuit des temps
croit-il, par cette femme qui se révélera fatale, Ole ne voit pas qu'il est
pris dans une toile d'araignée tissée par celle qui connaît sa vulnérabilité et
sa naïveté. Pourquoi n'a-t-il pas écouté l'un des quatre complices, son ami
Charleston (Vince Barnett), qui lui dit en quittant la pièce ? « Tu veux un conseil ? Laisse tomber les
harpes d'or. Elles peuvent te causer des tas d'ennuis ». « Où veux-tu en
venir ? » lui répond Ole, avec un étonnement non feint. Tout est dit dans
ce plan : Kitty, bien consciente du pouvoir qu'elle a sur les hommes et le
monde, est au cœur d'une dynamique émotionnelle et sensuelle à l'intérieur d'un
couple dissymétrique et improbable dont l'un est la marionnette de l'autre, et
qui ne peut connaître qu'une destinée tragique.
mercredi 6 mars 2019
L'hélicoptère chez Ridley Scott
L'épilogue de Thelma
et Louise (Ridley Scott, 1991) aurait pu se passer n'importe où dans le
Sud-Ouest américain. En Utah, en Arizona, dans le Colorado ou au Nouveau-Mexique, il y a des terres immenses où se perd l'œil, où le ciel
s'imbrique dans la terre, où l'horizon, en apparence infini, est brisé, de
temps à autre, par un canyon, fronton minéral se précipitant dans les
entrailles de la Terre. La poussière de roche ocre, est partout, soulevée par
un vent entêtant et sec, creusant et modelant les reliefs jusqu'à créer des
mesas, des gorges, des pitons rocheux, à côté desquels l'Homme n'est plus rien.
La route ou la piste qu'emprunte la Ford
Thunderbird décapotable de Thelma et Louise (photogramme 1) est une route de
fin du monde, une piste faite de sable, de pierres et de poussière, devant
laquelle peuvent surgir à tout moment une façade aux couleurs rougeoyantes ou un
précipice dont la profondeur s'accorde avec l'ampleur du lieu. Si Ridley Scott
a choisi de filmer la fuite de ces deux femmes, éprises de liberté et fuyant
l'ordre patriarcal, dans la majesté de Dead Horse Point (à côté de Canyonlands
National Park en Utah), c'est parce qu'au début du XXe siècle une légende
racontait que les cowboys utilisaient autrefois cet espace comme corral pour
les chevaux sauvages qui vagabondaient sur les hauteurs des plateaux. Encerclé
par des falaises abruptes, cet enclos naturel n'offrait aucune échappatoire aux
mustangs capturés. Certains d'entre eux furent oubliés et moururent de soif. Le
lieu est donc prémonitoire pour Thelma et Louise qui ont le FBI à leurs
trousses depuis que Louise a abattu un homme qui avait tenté de violer Thelma.
À ce moment précis, l'étau se resserre. Le surgissement de l'hélicoptère (coin
gauche du photogramme 1) rompt la fragile avance que les deux femmes avaient
réussi à installer avec leurs poursuivants. Tout petit d'abord, oiseau noir
sortant de nulle part, au bord du paysage et du cadre, l'hélicoptère fonce
progressivement sur nous, franchit le quatrième mur, pour se retrouver derrière
nous, plongeant en direction de la piste qui chemine en contrebas (coin droit
du photogramme 3). À plusieurs centaines de mètres d'altitude, il avance,
masqué par les masses rocheuses, surplombe le Colorado (photogramme 2) et,
méprisant les distances, se joue de ces déchirures du relief qui ressemblent à
un labyrinthe. En dépit de sa position dans les airs et de la menace qu'il
représente pour Thelma (Geena Davis) et Louise (Susan Sarandon), l'hélicoptère
est englouti dans ce paysage dépouillé jusqu'à l'épure. D'en haut, tout est
encore plus grandiose, architectural et cyclopéen, espace sauvage façonné par
cet orgueil qui sied à la nature ayant le temps pour elle, ce temps que n'ont
plus, hélas, les deux fugitives. Désormais sans attaches, libres de leurs
mouvements, dans l'incapacité de faire marche arrière, Thelma et Louise, dans
un suprême élan émancipateur, s'enfoncent dans cette terre indomptée, jusqu'à
l'ivresse.
lundi 4 mars 2019
Le cynisme et la veulerie chez Alexander Mackendrick
« Prenez
Sydney par exemple. Si Sidney s'approchait de Susie, je lui fendrais le crâne
avec une batte de base-ball ». Cette phrase assassine prononcée par J.J.
Hunsecker, puissant éditorialiste d'un journal new-yorkais, The Globe, (Burt
Lancaster, à gauche) à destination de Sidney Falco, un attaché de presse sans
envergure (Tony Curtis, à droite), n'est qu'une autre humiliation subie en
public, sans que cela ne suscite la moindre réaction de la part de ce dernier.
Bien au contraire, alors que J.J. s'apprête à porter une cigarette à ses lèvres,
Sidney a déjà dégainé un briquet pour satisfaire les faits et gestes de son
patron, sans que celui-ci n'ait besoin de dire un mot. Dans Le Grand Chantage (Sweet Smell of Success, 1957), Alexander Mackendrick dépeint deux
hommes aussi abjects et vils l'un que l'autre. Le premier fait et défait les
réputations des célébrités dans une presse à scandale tout en célébrant la
démocratie dans ses discours, alors que le second, avide d'argent et de
renommée, cherche par tous les moyens à s'attirer les bonnes grâces de J.J. pour devenir son âme damnée, son exécuteur des basses œuvres, en obéissant
servilement aux ordres donnés. L'attaché de presse est justement chargé de
rompre, par tous les moyens possibles, la relation amoureuse existant entre la
sœur de J.J., Susie (Susan Harrison) et un guitariste de jazz, Steve Dallas
(Martin Milner), union que refuse J.J. Dans une entente bien comprise, puisque
chacun a besoin de l'autre, J.J. et Sidney ne sont que deux facettes d'un même personnage
qui évolue dans les bas-fonds de l'âme humaine, un personnage–miroir, masquant
à peine ses instincts de tueur. Véritable démiurge, cynique et démagogue, sans
scrupules et sans éthique, J.J. aime humilier les autres et particulièrement
Sidney qui n'en a cure puisqu'il boit le calice jusqu'à la lie. Avec son
physique avantageux et sa logorrhée obséquieuse, Sidney virevolte, tourne
autour de J.J. comme une planète en orbite autour du soleil. Son geste rampant d'empressement
pour allumer la cigarette de J.J. s'inscrit dans un rituel de flagornerie, de
mensonge, de tricherie et d'hypocrisie qui fait de lui, à l'instar de Harry
Fabian (Night and the City/Les Forbans de
la nuit, Jules Dassin, 1950), un personnage paroxystique et pathétique. Ces
deux monstres font à New-York ce que The
Big Knife (Robert Aldrich, 1955) (1) a fait à Hollywood, c'est-à-dire décrire
un monde décadent, gangréné par les rapports de force, l'argent et le succès
qui se fait et se défait aussi rapidement que s'écrivent les éditoriaux. « Monsieur Falco est un homme aux quarante
visages, pas si jolis que cela et toujours trompeurs » dit une autre fois J.J.
Hunsecker. L'élève se révèle aussi brillant que le maître, prêt à piétiner les
autres pour parvenir à exister et à capter un peu de lumière qui irradie la
personnalité machiavélique de J.J. Le film « permet à Mackendrick d'autopsier au scalpel une société où le culte de
l'accessoire, la prédominance du médiatique sur la réalité détruisent la
hiérarchie des valeurs, abolissent la perspective, créent un système autarcique
capable de se suicider par suffisance » (2).
(1) Voir la
chronique Le générique chez Robert
Aldrich
(2) Cinquante
ans de cinéma américain de Jean-Pierre Coursodon et Bertrand Tavernier,
Éditions Nathan, 1995, p.681.
jeudi 28 février 2019
Les favorites chez Yorgos Lanthimos
Dans La
Favorite (The Favourite, Yorgos
Lanthimos, 2018), Sarah Churchill, duchesse de Marlborough (Rachel Weisz,
photogramme 2) est la confidente, la courtisane, l'éminence grise et la
favorite d'Anne (Olivia Colman), reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande
jusqu'à l'arrivée d'Abigail Hill (Emma Stone, photogramme 1), une ancienne
aristocrate déchue de ses droits qui cherche par tous les moyens à retrouver
une place à la cour royale, au plus près de la reine. Alors que la guerre de
Succession d'Espagne (1701-1714) fait rage à l'extérieur du royaume, une autre
guerre, plus larvée, plus insidieuse mais tout aussi mortelle se joue entre ces
deux femmes plus arrivistes et ambitieuses l'une que l'autre. Elles ont pris l'habitude
de se livrer, dans les jardins du Palais de Kensington, à une joute qui tient
davantage du règlement de comptes haineux que de l'aimable divertissement. Un
tir aux pigeons leur permet, en effet, de se mesurer l'une à l'autre sur la capacité
de chacune à abattre d'un coup de mousquet, le plus rapidement possible,
l'infortuné volatile qu'un serviteur aura préalablement lâché dans les airs. À
peine Abigail a-t-elle pointée son arme que l'oiseau est déjà abattu, éclaboussant
de son sang le visage de Lady Marlborough. Les taches écarlates qui constellent
la moitié droite de son visage, et qui lui donnent l'air de saigner, ne sont
qu'une préfiguration de ce qu'elle va connaître dans les jours qui suivront. La
favorite de la reine, celle qui gouverne à sa place, celle qui partage son
intimité et son lit vient de trouver sur son chemin une rivale encore plus
machiavélique et tueuse qu'elle. Ce sont ces deux femmes qui mènent une danse cruelle
autour de la dernière reine de la Maison Stuart; cette dernière n'est d'ailleurs
pas dupe des intrigues qui se trament autour d'elle. De soubrette à Secrétaire
financière en passant par dame de chambre, Abigail gravit un à un les échelons
du pouvoir de la même manière qu'elle manie le mousquet : avec une froide
détermination et une rage contenue à la hauteur des humiliations qu'elle a
subies dans sa jeunesse. Empruntant à
Barry Lyndon sa vanité et son désir de reconnaissance (Barry Lyndon, Stanley Kubrick, 1975), Abigail exprime dans sa
confrontation avec Sarah Churchill, tout autant une obsessionnelle quête de
puissance qu'un abandon vertigineux de tout sens moral. Jouxtant le palais, ce
terrain de jeu, en apparence bucolique, cerné par des haies savamment taillées
et ornementé de bosquets, de fontaines et d'étangs, n'est autre que le cadre
d'une dramaturgie toxique portée à l'incandescence. Abigail montre que l'on
peut abattre un adversaire sans forcément le tuer, mais elle ne sait pas encore que,
comme celle de la duchesse de Marlborough, son ascension irrésistible ne peut s'achever,
tôt ou tard, que par une inéluctable chute. Orfèvre en la matière (The Lobster, 2015 ou The Killing of a Secret Deer, 2017)
Yorgos Lanthimos filme la violence et la perversité des rapports humains qui
sous le faste de la dynastie des Stuart n'en révèle pas moins une vision
désespérée de la condition humaine.
La Floride chez John Schlesinger
Des palmiers, un ciel bleu, et bientôt la mer
défilent dans le reflet de la vitre du bus qui mène Rico Rizzo (Dustin Hoffman,
à gauche) et Joe Buck (Jon Voight, à droite), vers le Sunshine State. L'image idyllique de la Floride, métonymie du rêve
américain, surgit au matin du dernier jour de leur voyage. Partis de New-York
la veille, Rico et Joe sont deux marginaux, deux déclassés qui se sont
rencontrés fortuitement dans Big Apple.
Le premier est un escroc minable, clochardisé, infirme et malade vivant d'expédients
et de larcins, alors que le deuxième, candide et un peu nigaud, croyait que sa
mine de bellâtre, sa jeunesse vigoureuse, son stetson, sa veste à franges et
ses bottes de cowboy lui permettaient de quitter son Texas natal pour vendre
ses charmes à des femmes argentées et d'un âge certain, ne demandant que cela
parce que fascinées par le mythe du cowboy viril. Dans une société où il ne
peut y avoir de salut qu'individuel, leur compréhension mutuelle d'une aide
réciproque va sceller une amitié, d'abord conflictuelle, puis progressivement
fraternelle. S'impose alors une narration à deux voix nous décrivant deux
figures aux ailes brûlées, désillusionnées, paupérisées, dérivant dans les
quartiers les plus sordides de la ville. La terre promise new-yorkaise se
révélant une jungle urbaine oppressante, la Floride et son soleil permanent
serviront alors de boussole fantasmée à ces deux perdants, ces laissés- pour-compte,
exclus du miroir aux alouettes qu'est l'american
way of life. Débarrassé de ses habits de cowboy qui étaient censés lui
permettre de se lancer, à rebours des premiers colons, à la conquête de l'Est,
Joe vient d'acheter pour Rico et lui, des chemises de plage plus conformes au
climat et à la culture de la Floride, pour se lancer cette fois-ci, à la
conquête du Sud. « Il doit y avoir un
moyen plus facile pour gagner sa vie, un genre de travail au grand air »
dit-il à Rico apparemment assoupi, la tête reposant sur la vitre. Mais c'est à
un mort qu'il s'adresse. Épuisé, vidé de ses forces, terrassé par la
tuberculose, Rico vient de rendre son dernier soupir, alors que le bus est sur
le point d'arriver à Miami. Ironiquement, les palmiers imprimés sur sa chemise
se superposent aux palmiers qui jalonnent la route longeant la mer. Le rêve de
Rico s'est enfin réalisé mais à titre posthume, et dès lors transparait cette
amertume qui submerge ceux qui ne peuvent réaliser leurs aspirations, faute de
se départir de ce fatalisme social et de cette inaptitude à maîtriser les codes
qui pourraient leur permettre de s'intégrer dans la société. En guise d'oraison
funèbre, Joe le serre contre lui dans un geste d'amour. Du taudis dans le Bronx
au soleil de Floride, l'itinéraire de Rico et de Joe se solde par un échec,
même si Joe n'est plus le même par rapport à son départ du Texas. Alors que son
premier voyage – déjà en bus – le lançait à la conquête du monde à la manière
d'un John Wayne, le deuxième le voit métamorphosé autant d'un point de vue
vestimentaire que mental. Conscient de la dureté du réel, il avance désormais
seul vers un hypothétique avenir. La mort de Rico et le regard vide de Joe,
parachevés par le fondu au noir qui clôt Macadam
cowboy (Midnight Cowboy, John
Schlesinger, 1969), enterrent définitivement l'espoir de liberté et de
prospérité, deux facteurs constitutifs du rêve américain.
S'abonner à :
Messages (Atom)