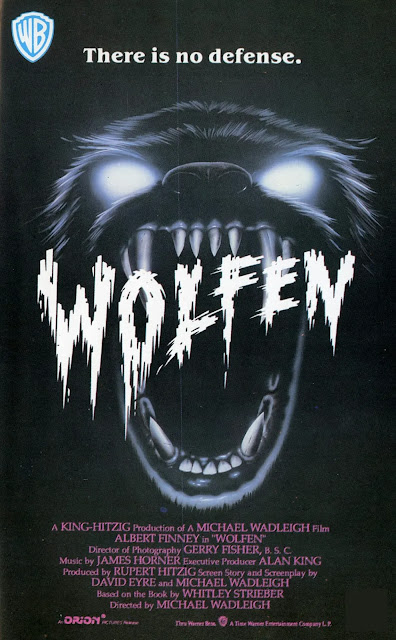Cadrant quelques secondes plus tôt le dos de Jubal Troop
(Glenn Ford assis à la table, en train de se retourner), la caméra vient
d’effectuer, en diagonale, un travelling arrière, particulièrement fluide et
rapide. En reculant, celle-ci élargit le champ pour introduire dans ce saloon faiblement
éclairé par une lampe à pétrole, Shep Horgan (Ernest Borgnine, à gauche du
photogramme)) qui, sa Winchester à la main, cherche à laver dans le sang un
affront qu’il ne peut pardonner. Celui-ci en effet soupçonne – à tort - Jubal
d’avoir une liaison avec sa femme Mae (Valérie French). Son attitude
corporelle, hiératique et menaçante, dit toute sa détermination, même si son
visage est coupé par les limites du cadre. Le travelling arrière permet le plus
souvent de passer du particulier au général, de la conversation qu’avaient,
autour d’une table, Jubal avec Reb Haislipp (Charles Bronson) au dévoilement du
saloon et au surgissement de Shep au premier plan. L’intérêt est double :
replacer le premier dans un décor qui l’isole, et faire de l’entrée dans le champ
du troisième, l’élément dramatique prompt à faire basculer le film dans la
tragédie. Jubal, encore assis sur sa
chaise, n’est certes pas seul, mais apparaît d’autant plus vulnérable qu’il ne
porte aucune arme. Dans le western, à côté du cheval et de la bouteille de
whisky, le colt ou la Winchester sont pourtant des éléments indispensables pour
survivre dans ces contrées de l’Ouest sauvage. Entrer dans un saloon aussi peu
vêtu équivaut donc au mieux à une faute d’inattention ou au pire à une naïveté
touchante concernant la bonté du genre humain. Rien de tel en fait chez Jubal
puisque celui-ci refuse la violence sous toutes ses formes en cherchant à
expurger un passé traumatisant – un père mort accidentellement par sa faute et
une mère toxique – et une errance qui s’apparentait à une fuite en avant jusqu’au jour
où Shep avait décidé de lui faire confiance en le nommant contremaître de son
exploitation. C’est dire l’originalité de ce personnage tourmenté que Delmer
Daves met en scène dans l’Homme de nulle part (Jubal, 1956) et
qui n’a jamais été aussi fébrile qu’à cet instant. Savoir à ce sujet que Shep était progressivement devenu pour Jubal un père de substitution ne rend la scène
que plus bouleversante. Le décor est donc
le saloon, un lieu emblématique du western, créateur de lien social, lieu de
rencontres, de rixes, de plaisirs coupables, de bacchanales et de jeux d’argent
en tout genre. Quand le cowboy assoiffé y entre, le plus souvent par une porte
à double battant, il n’est jamais assuré d’en ressortir vivant, mais le plus
souvent les pieds devant, le corps criblé par une giclée de plomb. À
l’arrière-plan, le barman s’est déjà éclipsé prudemment, probablement par une
porte arrière, et les quelques consommateurs encore présents, en fins
connaisseurs des risques encourus, sont eux en train de s’éloigner de la ligne
de mire du fusil de Shep. La tension est à ce moment à son comble. Grâce au
travelling, le réalisateur peut ainsi placer successivement et dans un même
mouvement, comme pour mieux galvaniser l’image, ses deux personnages principaux
dans la topographie d’un lieu clos. Puisque tout est net dans le plan, il donne
ainsi autant d’importance à Jubal qu’à Shep, afin de mieux rendre lisibles tous
les enjeux de la séquence : vengeance, jalousie, trahison, fatalité et
violence.
dimanche 23 juillet 2023
Le travelling arrière chez Delmer Daves
mardi 11 juillet 2023
La menace chez Jean-Marc Vallée
Au premier plan, filmée de dos,
légèrement floutée, Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) vient brusquement de se
retourner, le visage déformé par une vive incrédulité. Un homme (Charles Baker)
se tient en face d’elle aussi figé que les restes déchiquetés du tronc d’arbre
situé à sa gauche, et dont la base se perd au milieu de cet océan d’herbes
sauvages. À l’arrière-plan, l’horizon est bloqué par une ligne de conifères qui
s’apparente à une frontière derrière laquelle se devinent des espaces hostiles
et impénétrables comme il y en a tant dans la Sierra Nevada, à l’ouest des
États-Unis. La jeune femme venait quelques instants plus tôt de changer de
vêtements lorsqu’elle remarqua cet homme qui l’épiait manifestement depuis un
certain temps. La mise au point est faite sur cette figure inquiétante et
l’espace végétal qui l’entoure, comme si les deux ne faisaient plus qu’un.
Tétanisée par cette vision, imaginant le pire, Cheryl n’ose bouger. Dans cette
scène de Wild (2014), le wilderness n’est plus ce jardin d’Éden tant
glorifié par la mythologie de l’Ouest, mais un
décor tragique, un espace transformé en lieu clos mortifère et en réceptacle de
toutes ses peurs. À cet instant, le temps s’est arrêté. Il n’est plus rien au
monde que ces deux êtres dont chacun a dans les yeux de l’autre un aperçu de
l’éternité.
Ce chasseur menaçant, rencontré
quelques instants plus tôt, est revenu sur ses pas. Dans son hiératisme,
semblant surgi de nulle part et rendu quasi invisible par sa veste de camouflage, il incarne, à
l’instar des rednecks dégénérés de Deliverance (John Boorman,
1972) l’archétype du primitif, une matérialisation sombre et sinistre de la
part refoulée de l’humanité. Avec sur son dos un râtelier sur lequel sont fixés
un arc et de longues flèches métalliques, en plus d’un long couteau pendant à
sa ceinture, l’homme marque ce territoire inhospitalier de sa présence en
montrant bien que celui-ci ne peut se conquérir que par la violence, et non en
le traversant de manière transitoire, comme Cheryl. Doté d’une nature sauvage
et de pulsions qu’il ne cherche pas à dissimuler, il évolue dans ces terres
vierges, sans carte ni boussole, avançant instinctivement dans l’espace
forestier comme s’il y avait toujours vécu. Au milieu de la clairière parsemée
d’arbres morts, réduit à une fonction menaçante et donnant l’impression de
privilégier cet instant de plaisir pervers, l’homme introduit un malaise, une
insécurité encore renforcée par la
vulnérabilité de Cheryl dont les épaules affaissées traduisent une angoisse
asphyxiante. Enfin, cette confrontation annonciatrice d’un danger mortel permet
à Jean-Marc Vallée de ne dessiner rien de moins qu’une vision du monde dans
laquelle une ligne de fracture oppose violence et civilisation, régression
morale et humanisme, comme pour nous dire que de cette nature, à bien des
égards fascinante, peut naître à tout instant le drame.
Pour le réalisateur, les
États-Unis sont d’abord un territoire à parcourir aux dimensions inégalées, un
espace rédempteur qui doit permettre à Cheryl, après une série de drames
personnels et une vie chaotique et autodestructrice (le décès de sa mère, un
divorce, une dépendance à l’héroïne, des
aventures sexuelles sans lendemain), de dénouer une crise existentielle, et de
trouver une issue pour expurger le désordre qui organisait sa vie et ainsi apaiser une déchirure que seul le contact d’une
beauté virginale pouvait transfigurer. Aussi mal préparée que les pionniers
d’autrefois, Cheryl parcourt, sous un ciel immense avec comme ligne de mire la
silhouette des montagnes, non plus d’est en ouest mais du sud au nord, le
Pacific Crest Trail, un sentier qui, de la frontière américano-mexicaine
jusqu’à celle du Canada, serpente sur 4200 km, traversant successivement la
Californie, l’Oregon et l’État de Washington. Du désert aride de Mojave aux
forêts profondes de la chaîne des Cascades, en passant par les sommets enneigés
de la Sierra Nevada, Cheryl est confrontée tout autant à une nature vierge
comme au commencement du monde, belle mais impitoyable – et dans laquelle il est
possible de se perdre comme Christopher McCandless (Emile Hirsch dans Into the Wild, Sean Penn, 2007) – qu’à
ses propres démons réanimés par l’apparition
de ce chasseur. Il y a incontestablement chez Jean-Marc Vallée quelque chose
d’Anthony Mann dans sa manière de décrire un personnage aux multiples fêlures
intérieures, solitaire mais libre, coupé provisoirement de son milieu
d’origine, et constamment absorbé par un environnement qui lui reste supérieur.
Cheryl ressemble alors à Vance Jeffords (Barbara Stanwyck dans The Furies,
1950) ou à son équivalent masculin Lin McAdam (James Stewart dans Winchester ‘73, 1950).
Plus souvent parcourue en
voiture, en moto ou en camion (Grapes of Wrath, John Ford, 1940 ; Easy Rider, Dennis Hopper, 1969 ; Vanishing
Point, Richard C. Sarafian, 1971 ; ou encore Thelma & Louise,
Ridley Scott, 1991), mais aussi à pied comme Charlie Chaplin et Paulette
Goddard dans le dernier plan de Modern Times (Charlie Chaplin, 1936), Al
Pacino et Gene Hackman faisant du stop tout au long de Scarecrow (Jerry
Schatzberg, 1973) sans oublier Emile Hirsh arpentant les grands espaces
jusqu’au bout de la piste (Into the Wild, déjà cité[1]),
ou encore à cheval à l’image de John Wayne à la recherche de sa nièce (The
Searchers, John Ford, 1956) et de Clint Eastwood à la poursuite des
meurtriers de sa famille (The Outlaw Josey Wales, Clint Eastwood, 1976),
la route fait partie intégrante de la mythologie américaine fondée sur
l’histoire d’un territoire en expansion. Consubstantielle à l’immensité de ce
pays, et tout aussi magnifiée par les mots de Mark Twain, Jack London ou Jack
Kerouac, elle permet en effet de saisir, jusqu’à l’exaltation, ce sentiment de
liberté, d’ouverture, mais aussi, parfois, de péril et d’impuissance.
lundi 3 juillet 2023
Les loups de Wall Street chez Michael Wadleigh
2
Sur Wall Street à New-York, à quelques mètres de la
Bourse, avec sa colonnade rendue encore plus impressionnante par la
contre-plongée de la caméra, Federal Hall a été le berceau de la vie politique
américaine. C’est en ces lieux[1],
en 1785, que se sont réunis, au lendemain de la guerre d’Indépendance et avant
de s’installer à Philadelphie puis définitivement à Washington, les premiers
gouvernement et Congrès de la jeune histoire des États-Unis. La statue de
George Washington, à droite du cadre (photogramme 1), rappelle également que
c’est ici que celui-ci prononça en tant que Président, son discours
d’investiture le 30 avril 1789. Ce bâtiment austère et imposant, se dressant
comme une ombre menaçante au sud de la ville, semble écraser la scène qui se
déroule au niveau de la rue.
Une meute de loups menaçants vient de surgir de l’obscurité. L’un deux s’est élancé sur le capot d’une voiture dans laquelle le commissaire de police Warren (Dick O’Neill) vient de se réfugier (photogramme 1), alors qu’un autre, toute fourrure hérissée et canines agressives découvertes, s’est immobilisé sur le péristyle de l’édifice (photogramme 2), prêt à une attaque prédatrice. Venus du quartier délabré du Bronx dans lequel ils ont élu domicile, ils rôdent sur ce territoire new-yorkais en égorgeant tous ceux qui ont le malheur de s’approcher d’une église en ruine utilisée comme repaire. Ne faisant aucune distinction entre les clochards et les ivrognes errant dans le ghetto et dont les cadavres lacérés sont découverts sous les gravats des immeubles en cours de destruction, à l’instar du corps déchiqueté d’un riche promoteur immobilier de Manhattan impliqué dans la rénovation du Bronx gisant, aux côtés de celui de sa femme et de son garde du corps, dans le jardin de Battery Park au sud de Manhattan, ces loups tuent pour que leur territoire reste inviolé. Ils tuent autant pour se protéger que pour se nourrir, tout en incarnant la mauvaise conscience des descendant des premiers colons qui les avaient éradiqués au XIXe siècle, au même titre que les communautés amérindiennes qui vivaient si bien en symbiose avec les canis lupus qu’ils en avaient fait un animal-totem. Ces communautés, autrefois libres et souveraines, mais toutes deux victimes de la modernité, opposent à la civilisation actuelle le monde sauvage d’avant la conquête, d’avant l’arrivée de l’homme blanc et de sa rage destructrice vis-à vis de tout ce qui se trouvait en travers de sa route. Loups et Amérindiens, devenus les fantômes des États-Unis, peuplent désormais les espaces déshérités des grandes villes, à la périphérie de la multitude amnésique de sa propre histoire. En choisissant, enhardis par l’odeur du sang, de pénétrer le cœur originel de la démocratie américaine, les loups défient donc l'histoire d'un pays qui s'est construit dans la violence et le sang. Dans Wolfen (1980), Michael Wadleigh fait de ces apparitions spectrales le retour d’un refoulé culpabilisateur dont l’Autre (l’homme et l’animal) n’est que le miroir dans lequel l’Amérique peine à refléter sa part sombre.
À la lisière du fantastique, du thriller et de la
parabole politique, le film emprunte encore à l’esprit du Nouvel Hollywood, en
ce sens qu’il décrit à la manière de William Friedkin (French Connection,
1974) un New-York profondément inégalitaire, gangrené par la ségrégation
urbaine et ses inégalités sociales. Au moment où le cinéma reaganien et sa
bonne conscience vont prendre leur envol, Wolfen fouaille encore la
plaie en faisant un parallèle entre l’éradication des loups et celle des
peuples amérindiens dont les descendants, comble du paradoxe, alors qu’ils
avaient été chassés de leurs terres, se retrouvent à construire, entre ciel et
terre, les gratte-ciels et les ponts d’une Amérique qui les avait rejetés.
[1]
En fait, le bâtiment d’origine fut détruit en 1812 puis reconstruit pour servir
tour à tour de bureau des douanes, d’Hôtel de Ville et depuis 1972 de musée.