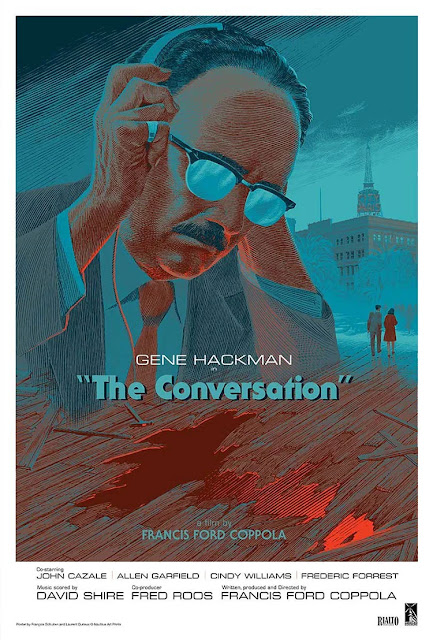Contrairement à Bread and Roses (2000) décrivant une immigrée clandestine mexicaine, femme de ménage dans un immeuble de Los Angeles, The Old Oak (Ken Loach, 2023) suit Yara (Ebla Mari), une immigrée légale syrienne tentant de se reconstruire au sein de la société anglaise post-Brexit, volontiers xénophobe vis-à-vis de tous ces exilés . Dans une arrière-salle de l’Old Oak, l’unique pub décrépi d’un village du nord de l’Angleterre, elle regarde avec beaucoup d’attention les photographies encadrées accrochées au mur qui présentent toutes des instants pris sur le vif de la grande grève des mineurs houillers britanniques du Yorkshire entre 1984 et 1985. Ces clichés montrent l’immense mobilisation des ouvriers, unis autour de slogans bien visibles sur les pancartes hâtivement confectionnées: « Victory to the miners », « Give me a future » et « Close a pit, kill a village ». Ces hommes forment une masse compacte, comme un seul peuple soulevé par la colère, résolu, dans cette lutte à mort contre le patronat et le gouvernement, à sauvegarder son mode de vie et sa cohésion sociale. Certains d’entre eux tentent de sourire devant l’objectif, mais l’envie n’y est pas. Peut-être savent-ils déjà que la lutte est inégale et que leur volonté de préserver leurs emplois en continuant à descendre plusieurs centaines de mètres sous terre pour en extraire du charbon, ne pèse rien face à la Première Ministre Margaret Thatcher, plus inflexible que jamais sur sa détermination à fermer les puits déficitaires et à faire plier le puissant syndicat des mineurs, le National Union of Mineworkers. L’objectif du gouvernement conservateur était, à ce moment, d’entériner la transition du pays vers une société néolibérale de services, plus rentable à ses yeux que cette industrie charbonnière qui fit pourtant du Royaume-Uni le berceau de la Révolution industrielle au XIXe siècle.
Mais à travers les yeux de Yara, c’est
bien Ken Loach qui retourne aux sources de son militantisme, en ce sens que les
années 80, indissociables de la révolution conservatrice thatchérienne opposée
à la pensée interventionniste keynésienne, ont profondément influencé son
cinéma. Nulle nostalgie dans son regard, mais une rage intacte à dénoncer, de son
documentaire A Question of Leadership (1981) à The Old Oak en
passant par Raining Stones (1993) ou I, Daniel Blake (2016) les
inégalités sociales, la destruction de l’État-providence, le cynisme et le
mépris affichés par une partie de la classe politique britannique et les adorateurs
de la main invisible du marché vis-à vis du lien social. L’échec particulièrement
amer de la grève donne au plan sa dimension tragique. Que son cri retentisse dans
le vide dans un Royaume-Uni envoyant invariablement de 2010 à 2024, en dignes
héritiers de la « Dame de fer », des Premiers Ministres conservateurs, ne rend
que plus indispensable son engagement politique et son désir de hisser très
haut les valeurs humaines de solidarité et de dignité. Dans ce rôle écrit tout
en sensibilité par le toujours fidèle scénariste du réalisateur, Paul Laverty,
Yara, le regard rivé sur ces photographies, ne peut être que troublée par elles.
Photographe talentueuse, la jeune femme se
projette inévitablement dans cette communauté fracassée qui lui rappelle la
sienne et son pays, la Syrie, qu’elle a dû fuir avec une partie de sa famille.
Cet effet miroir renvoie aux photos qu’elle a ramenées de son pays natal, montrant
les visages certes abîmés de ses compatriotes, mais toujours empreints d’une
dignité que le malheur ne saurait vaincre. Ces images fixes du passé et du
présent traduisent donc bien le sentiment de perte et la matérialisation de
l’effondrement de deux communautés, distinctes certes, mais désormais réunies dans
une même réalité meurtrie. De cette prise de conscience d’une solidarité
transcendant les frontières, Ken Loach sait, comme à son habitude, faire naître
l’espoir d’un monde tel qu’il pourrait être : universaliste et altruiste.