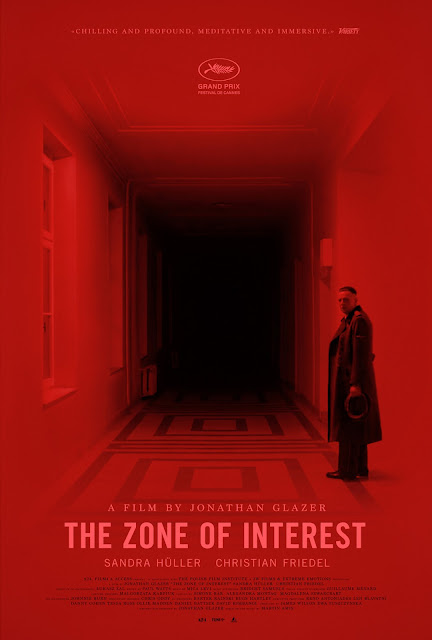« Tout près du camp, le commandant a sa villa,
où sa femme contribue à entretenir une vie familiale, et quelquefois mondaine,
comme dans n’importe quelle autre garnison. Peut-être seulement s’y
ennuie-t-elle un peu plus : la guerre ne veut pas finir ». Ces phrases
extraites du texte inoubliable rédigé par Jean Cayrol et narrées en voix off
par Michel Bouquet dans Nuit et brouillard (Alain Resnais, 1955) renvoient,
comme un écho mortifère traversant les décennies, au film La Zone d’intérêt
(The Zone of Interest, Jonathan Glazer,2023) mettant en scène une
famille nazie vaquant à ses activités quotidiennes dans une maison champêtre située
à la périphérie d’Auschwitz-Birkenau, et dont le père n’est autre que Rudolph Hoess
(Christian Friedel), le commandant de ce camp de concentration et
d’extermination.
Cela fait maintenant quelques années que cet
homme est entré dans la nuit et l’ignominie, particulièrement depuis qu’il est
devenu commandant d’Auschwitz-Birkenau le 1er mai 1940. Cette
promotion ne relève en rien du hasard, puisqu’il était manifestement prédestiné
à ce poste. Nazi convaincu et assumé depuis 1922, arrêté et incarcéré en 1924 pour
le meurtre d’un militant communiste, entré dans la SS en 1934, d’une obéissance
confinant à la servilité vis-à vis de sa hiérarchie, Hoess a été repéré par
Himmler pour organiser méthodiquement et scientifiquement l’extermination de millions
de déportés dans un camp qui résume à lui seul l’abîme totalitaire et
génocidaire.
Avec tout
le naturel et le détachement qui conviennent à un tortionnaire zélé, sans état
d’âme, ni conscience, d’une banalité consternante, ce gardien de la pureté de
la race pense pourtant agir en homme moral puisqu’il faut à n’importe quel prix
protéger la communauté allemande de tous les corps étrangers, juifs, slaves,
homosexuels, tziganes, qui la menacent. De passage à Berlin, après une longue
journée de réunions, il vient de quitter son bureau pour descendre les marches
de l’escalier d’un bâtiment gouvernemental vide, plongé dans une semi-obscurité.
Soudain, et à plusieurs reprises, il s’arrête, se courbe en avant, pris de
violents haut-le-cœur, saisi d’une irrépressible envie de vomir qu’il ne
parvient pas à maîtriser. Au contraire de son esprit verrouillé, incapable
d’éprouver la moindre émotion, la moindre culpabilité, ses organes viciés, eux,
soulignent l’abjection de sa fonction dans le déroulement de l’Holocauste. Quand
le malaise devient insurmontable, quand l’horreur enfouie au plus profond de sa
chair cherche son chemin, le corps de Hoess dégurgite une bile dont les traces
maculent le sol et les marches de l’escalier. Il vomit parce que son estomac ne
supporte plus les ondes de choc résultant du meurtre de masse, des cris de
terreur de celles et ceux qui entrent dans les chambres à gaz, des odeurs de la
chair et des cheveux qui brûlent. Ne serait-ce que pour quelques instants, Hoess,
le monstre bureaucratique, l’employé modèle d’une usine de la mort, doit lutter
contre le vertige métaphysique du néant. Ce n’est même plus un compromis entre
l’âme et le corps, mais une dichotomie nette, tranchée, entre une conscience
sans conscience et la normalité d’un organisme qui réagit aux agressions
extérieures. Quand la moralité a sombré depuis
longtemps dans les abîmes de la dégénérescence de l’âme, seul ces déjections expriment
la violence des crimes abjects que cet être médiocre a perpétrés.
Filmer la Shoah a toujours été une gageure pour
les cinéastes. Comment montrer le cœur de l’enfer, de l’Holocauste, sans tomber
dans le voyeurisme ou la complaisance ? Gillo Pontecorvo s’était attiré jadis les
foudres de certains critiques français comme Jacques Rivette[1] ou Jean-Luc Godard à la
suite de son travelling dirigé vers le cadavre d’une déportée accrochée à des
barbelés d’un camp de concentration (Kapo, 1961). De la même façon, Steven
Spielberg s’était vu reprocher par un autre critique, Louis Skorecki[2], de transformer
l’Holocauste en spectacle, particulièrement avec la scène de la douche à
Auschwitz (Schindler’s List, 1993). Depuis 1985, Claude Lanzmann avec Shoah
ne cesse de dire, avec ses neuf heures de projection constituées exclusivement
de témoignages recueillis quarante ans plus tard, que seule cette manière de
filmer prévaut pour éviter toute reconstitution et toute dramatisation
forcément factice. Laszlo Nemes, dans Le Fils de Saul (2015) avait
pourtant contredit avec force cet oukaze maintes fois renouvelé en mettant en
scène, au plus près, le membre d’un Sonderkommando chargé d’accueillir les
déportés, de les pousser à se déshabiller, avant de les accompagner vers la
chambre à gaz, puis, une fois les portes refermées, de récupérer leurs effets
personnels avant de sortir les cadavres, le gaz ayant fait son œuvre de mort,
pour les envoyer dans les fours crématoires. Rien ne se voit, ou à peine, mais
tout s’entend dans ce cauchemar hurlant. Avec son film, Jonathan Glazer montre, à son tour, qu’il est encore possible,
en rejetant toute l’horreur concentrationnaire au-delà du mur qui ceinture la
maison familiale, de filmer autrement la Shoah.